|
|
|
|
|
|
|
| Diapason, mars 2010 |
| Par Emmanuel Dupuy |
|
|
|
Jonas Kaufmann - Le nouveau romantique |
 Prudence
et passion Prudence
et passion |
|
| Fotos: Titel, Decca, Uli Weber//Carmen,
ROH, Catherine Ashmore//Lohengrin, Wilfried Hösl, Bayerische
Staatsoper//Dietmar Scholz (Decca) |
|
L’an dernier vous l’avez élu «Artiste de
l’année» et il vient de triompher dans Werther à l’Opéra de Paris. Avec son
nouvel enregistrement de La Belle Meunière, Jonas Kaufmann ajoute encore une
victoire à son copieux palmarès. Confidences d’un ténor qui a choisi de
donner du temps au temps et qui préfère brûler les planches que se brûler
les ailes.
Paris ne l’a découvert qu’en 2004, Cassio dans un passable Otello où l’on ne
voyait et n’entendait que lui, voix de bronze, présence monumentale, et déjà
ce mélange de contrôle, d’émotion et de sensualité qui est devenu sa marque.
Trois ans plus tôt, un certain Nicolas Joel (tiens, tiens...) lui avait fait
faire ses débuts français dans Mignon à Toulouse. Jonas Kaufmann avait alors
quelques années de carrière derrière lui, sagement mûries, à l’ancienne,
dans des théâtres de troupe allemands et suisses. L’astre s’est donc
épanoui, passant de Jaquino à Florestan, de Remendado à Don José, de Gastone
à Alfredo. Dans Fierrabras au Châtelet, Traviata et Fidelio à Garnier, il
nous est revenu, chaque fois plus solaire. Aujourd’hui, à tout juste
quarante ans, il est parmi les chanteurs les plus demandés de la planète,
cultivant un répertoire qui lui non plus ne connaît guère de frontières,
consacré par les francs succès discographiques que lui a offerts son contrat
avec Decca. Pour l’heure, c’est entre deux représentations de Werther que
nous le retrouvons (cf. nos pages Vu et entendu), sa dernière conquête,
accomplie — dans tous les sens du terme — sur la scène de l’Opéra-Bastille.
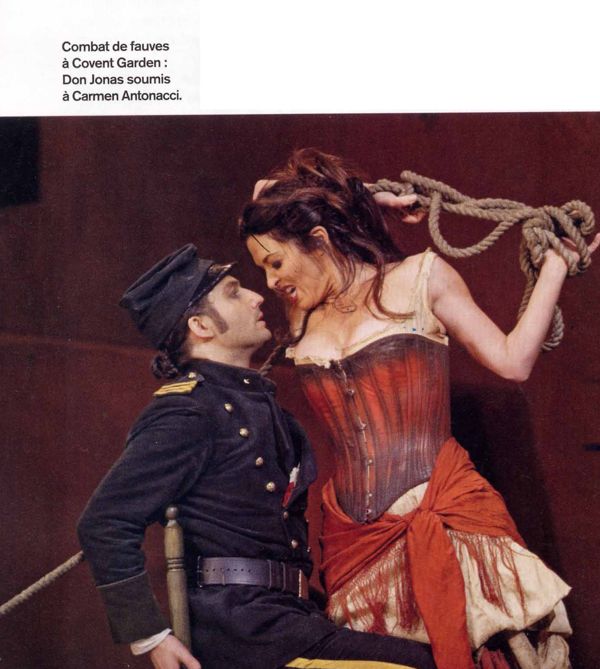 Jonas
Kaufmann: Le caractère de Werther est un peu difficile pour moi qui ne
suis pas dans ce genre de souffrance permanente! Mais c’est un rôle qui me
convient car il combine idéalement le romantisme allemand, un peu lourd, un
peu trop cérébral, avec la musique française qui permet d’exprimer toutes
les émotions — les compositeurs allemands vont beaucoup moins loin dans ce
sens, ils suivent davantage un système ou une idée. Vocalement, je ne
ressens aucune lourdeur, car on peut jouer avec des couleurs et des
inflexions différentes, on n’est pas toujours entre le forte et le
fortissimo, obligé de se concentrer sur les aigus ou le volume. Il y a au
contraire un besoin de flexibilité permanent très bon pour la voix. Jonas
Kaufmann: Le caractère de Werther est un peu difficile pour moi qui ne
suis pas dans ce genre de souffrance permanente! Mais c’est un rôle qui me
convient car il combine idéalement le romantisme allemand, un peu lourd, un
peu trop cérébral, avec la musique française qui permet d’exprimer toutes
les émotions — les compositeurs allemands vont beaucoup moins loin dans ce
sens, ils suivent davantage un système ou une idée. Vocalement, je ne
ressens aucune lourdeur, car on peut jouer avec des couleurs et des
inflexions différentes, on n’est pas toujours entre le forte et le
fortissimo, obligé de se concentrer sur les aigus ou le volume. Il y a au
contraire un besoin de flexibilité permanent très bon pour la voix.
Le fait d’être allemand apporte-t-il quelque chose à votre
interprétation?
J.K. : Werther fait partie de ma culture, c’est certain. Comme
beaucoup de petits Allemands, j’ai lu à l’école l’original de Goethe. Entre
le roman et l’opéra, c’est la même histoire mais peut-être pas, si je peux
me permettre, la même qualité littéraire! Sans la musique, le texte du
livret serait nul. Mais c’est toujours le problème avec les opéras qui
s’inspirent d’une oeuvre extraordinaire, il faut beaucoup couper, sacrifier
de nombreux détails. La psychologie des personnages est elle aussi souvent
simplifiée mais c’est notre responsabilité, entant qu’interprète, de le
faire oublier, en ne limitant pas notre approche à celle du livret, en
pensant au contraire à toute la complexité de l’oeuvre qui lui a donné
naissance.
La mise en scène de ce Werther était assurée par Benoit Jacquot. Que vous
a apporté son expérience de cinéaste?
J.K. : Au début des répétitions, il m’a dit «J’ai lu dans une de tes
interviews que tu n’aimes pas beaucoup répéter: ça tombe bien, moi non plus!
Au travail dans le détail,je préfère le naturel, l’intensité, la
connaissance.» En fait, il a vraiment eu une approche cinématographique,
ayant même recours à la notion de gros plan. Et ça marche, car il a réussi à
focaliser les regards sur des petites choses qui constituent l’action, en
faisant abstraction de ce qu il y a autour. C’est un beau spectacle qui
croit en la force et en la magie de la musique, sans chercher à en rajouter
ou à s’y substituer, contrairement à de nombreuses mises en scène.
Pourtant, à la différence du cinéma, le théâtre lyrique est un genre très
peu réaliste.
J.K. : Oui, c’est ce qu’on dit, car certaines situations n’existent
qu’à l’opéra. Dans le monde normal, personne ne pourrait croire à ce qui se
passe dans Cosi fan tutte, quand les deux garçons reviennent sur scène
déguisés et que leurs fiancées ne les reconnaissent pas. Mais nième dans un
cas aussi extrême, on peut trouver des solutions logiques. Pour mon premier
Cosi à Milan, c’est Strehler qui signait la mise en scène, il avait beaucoup
attendu à cause de cette difficulté. Pour lui, il ne fait guère de doute que
les femmes reconnaissent les hommes, mais comme les deux couples se
fréquentent souvent, sont amis, font tout ensemble, elles ac ceptent
l’invitation à échanger leurs partenaires, d’autant que ces derniers sont
plutôt anticonformistes. A l’opéra, 99% des histoires parlent d’amour, de
mort, de jalousie, trois choses auxquelles tout le monde est confronté,
aujourd’hui comme aux siècles passés. A partir de ces problèmes-là, on peut
toujours créer une histoire crédible et qui touche les gens, parce qu’Us s’y
reconnaissent, comme au cinéma. Dans un cas ou dans l’autre, on travaille
avec des lumières, des costumes, des maquillages, de la musique... La seule
différence est qu’à l’opéra, on ne peut pas avoir recours aux effets
spéciaux et au montage qui permet d’enchaîner les scènes ou de les refaire
plusieurs fois
Depuis toujours, vous revendiquez la diversité de votre répertoire et le
refus de la spécialisation. Mais cette diversité, de Lohengrin à Des Grieux,
ne présente-t-elle aucun risque?
J.K. : Au contraire, ces changements permettent de garder une
certaine fraîcheur vocale. C’est comme le moteur d’une voiture: si vous
conduisez uniquement dans Paris, en utilisant toujours le stop and go, ce
n’est pas bon, il faut aussi faire de l’autoroute La voix est un système de
muscles dont on ne sollicite souvent qu’une partie des capacités. C’est à la
fois dommage et dangereux car arrive alors un moment où vous ne pensez même
plus à la façon dont vous chantez. Si je me contentais de cinq rôles, je
n’aurais plus besoin de répéter, de faire des exercices, et je n’aurais plus
conscience des petites modifications qui interviennent forcément, avec les
années. Changer de répertoire m’oblige à des remises en question qui me
permettent de comprendre immédiatement si quelque chose ne va pas : je ne
travaille pas en mode automatique, mais toujours en manuel! Et chaque
répertoire se nourrit des autres. Le style italien aide énormément, quand on
aborde Wagner, à chanter vraiment legato, à jouer avec le texte sans
interrompre la ligne, ce qui est toujours un risque avec l’allemand.
Beaucoup de mes compatriotes chantent Wagner sans être capable de ce
caractère «liquide ».
Vous évoquez là une mauvaise tradition qui sévit de,puis plusieurs
décennies...
J.K. : C’est vraiment une fausse tradition. Quand on lit les lettres
de Wagner, on comprend clairement qu’il souhaitait que ses opéras soient
chantés selon les règles du style italien. A l’inverse, une certaine
robustesse exigée par le répertoire allemand peut être utile dans les
ouvrages français qui combinent toujours différentes dimensions vocales. Ce
n’est pas le cas chez Verdi, où les choses sont plus catégorisées, chaque
rôle étant écrit pour un type de voix bien particulier : ténor léger, ténor
lyrique, ténor dramatique... Don José, Des Grieux ou le Faust de Berlioz
sont des rôles lyriques qui évoluent vers des moments beaucoup plus corsés.
L’Invocation à la Nature est presque écrite pour un « helden baryton» Dans
de tels passages, l’expérience des opéras allemands peut être très
enrichissante.
 On
vous sent cependant d’une prudence extrême avec Wagner. Même avec Walther
des Maîtres chanteurs, probablement le plus lyrique de ses grands rôles de
ténor, que vous n’avez chanté qu’une seule fois, en concert... On
vous sent cependant d’une prudence extrême avec Wagner. Même avec Walther
des Maîtres chanteurs, probablement le plus lyrique de ses grands rôles de
ténor, que vous n’avez chanté qu’une seule fois, en concert...
J.K. : C’est vrai. Le problème avec Walther, c’est la longueur du
rôle, et c’est aussi une question de stress. J’ai la chance de ne jamais
être nerveux, mais cet air du troisième acte, que tout le monde attend à la
fin de l’ouvrage, cela met une certaine pression... En général, vous avez
raison de dire que, pour le répertoire wagnérien,j’y vais doucement. Etant
allemand, il serait très facile de remplir mon agenda uniquement avec
Wagner. Et ça, comme je vous l’ai expliqué, ce serait une faute.
Vous avez tout de même abordé Lohengrin à Munich, l’été dernier. Et
ensuite?
J.K. : Siegmund est prévu à New York en 2011 je crois. Beaucoup de
gens m’ont dit : jusqu’à ce que tu n’aies plus ton do, ou les aigus absolus,
il n’est pas du tout nécessaire d’aborder un rôle aussi grave que Siegmund.
Mais cela ne me paraît pas illogique, parce que je suis capable de chanter
presque comme un baryton et ma voix a aussi ce côté sombre. Walther arrivera
environ deux ans plus tard. Pour les autres, Siegfried, Tannhäuser et
surtout Tristan, je dois attendre. On m’a souvent demandé Tristan, sûrement
par manque de candidats! C’est un rôle formidable, fascinant, surtout dans
le troisième acte où Wagner a mis une force psychologique incroyable.
J’aimerais beaucoup le chanter un jour, mais, pour l’instant, c’est un trop
grand risque.
Dans votre parcours wagnérien, il y aura l’été prochain une étape
importante vos débuts à Bayreuth. Pourquoi n’est-ce pas arrivé plus tôt?
J.K. : J’avais été invité pour un autre projet mais la combinaison du
chef d’orchestre et du metteur en scène ne me satisfaisait pas. D’autre
part, je n’étais pas intéressé par des rôles plus secondaires comme David
des Maîtres chanteurs. Du coup, j ‘ai préféré attendre le moment approprié.
Ce Lohengrin avec le très iconoclaste Hans Neuenfels est donc le moment
approprié...
J.K. : Oui, je le connais, j’ai déjà travaillé avec lui. Je ne
m’attends pas à une production traditionnelle, mais c’est un homme qui a une
très grande expérience de l’opéra et n’a par conséquent pas besoin de
provoquer pour devenir célèbre. Chez lui, la provocation, que l’on
retrouvera sans doute dans ce Lohengrin, correspond toujours à une idée, un
projet, une conception. Pas comme avec certains jeunes metteurs en scène qui
signent une première production dans un grand théâtre ou dans un grand
festival et se croient obligés de provoquer un scandale pour qu’on parle
d’eux.
Chanter à Bayreuth, aujourd’hui, cela représente quelque chose
d’important?
J.K. : Pour moi qui suis allemand, sans doute. Malheureusement, au
cours des dernières années, les chanteurs n’étaient pas toujours les
meilleurs du monde. Peut-être le festival traverse-t-il une phase plus
expérimentale... Mais j’espère que l’on retrouvera le niveau incroyable que
révèlent les vieux enregistrements des années 1930, 50 et 60, ou des
productions de première qualité, comme le Ring de Chéreau. Et outre le
niveau immuable de l’orchestre, des choeurs et de l’acoustique, ce qui me
plaît, c’est que tout le monde est là pour s’amuser avec Wagner. On ne va
pas à Bayreuth exactement dans une logique de travail, plutôt pour y passer
des vacances...
A part Wagner, quels sont vos projets?
J.K. : La prochaine prise de rôle, c’est Maurizio dans Adriana
Lecouvreur. Puis viendront encore d’autres opéras italiens, Fanciulla del
West, Butterfly, Trovatore, Manon Lescaut. Et pour le versant français, Enée
des Troyens...
Depuis quelques années, grâce au contrat qui vous lie à Decca, vous avez
aussi une très importante activité discographique. Que vous apporte le fait
d’enregistrer?
J.K. : A notre époque, c’est un grand cadeau, surtout quand une
maison de disques vous soutient, vous propose des projets et vous laisse
faire vos propres choix. La Belle Meunière, par exemple, ce n’était pas une
idée de Decca, parce que ce n’est pas forcément un best-seller. Mais pour
moi, il était primordial de l’enregistrer maintenant, avec une certaine
jeunesse vocale et mentale. Dans quinze ans, je ne comprendrai peut-être pas
entièrement les idées et la situation de ce jeune homme qui suit la
fantaisie de son premier amour.
Le lied tenait-il une grande place dans l’enseignement que vous avez
reçu?
J.K. : Oui, à partir du moment où j’ai compris comment il fallait
l’aborder, de façon plus expressive qu’introvertie. Quand j’ètais au
conservatoire, je chantais le lied de manière artificielle, avec une voix
complètement différente. Helmut Deutsch, qui était mon professeur et qui est
devenu mon pianiste, m’a montré d’autres voies et m’a incité à me laisser
guider par les émotions, comme à l’opéra, à rechercher un certain
naturalisme.
Et que vous ont apporté les leçons de Hans Hotter? Lui aussi cultivait
dans le lied un certain naturalisme!
J.K. : Il adorait raconter des histoires, parfois amusantes, surtout
sur Strauss qu’il avait fréquenté. C’était très intéressant de connaître
ainsi la genèse de quelques lieder qui sont presque sacres pour nous, mais
qui ont été écrits très simplement, comme s’il s’agissait d’un travail
alimentaire
 A
l’opposé d’un Hotter, ces dernières décennies, l’interprétation du lied a
été marquée par une approche plus intellectualisée, incarnée par
Fischer-Dieskau. A priori, ce n’est pas trop votre tasse de thé... A
l’opposé d’un Hotter, ces dernières décennies, l’interprétation du lied a
été marquée par une approche plus intellectualisée, incarnée par
Fischer-Dieskau. A priori, ce n’est pas trop votre tasse de thé...
JK. : Exact. A la génération de mes parents, deux camps s’opposaient,
les partisans de Fischer-Dieskau d’un côté et ceux de Hermann Prey de
l’autre. Dans ma famille, on était toujours pour Prey I J’ai grandi avec ses
disques et ceux de Fritz Wunderlich. Pour moi les choses étaient claires...
Pourquoi avoir commencé par La Belle Meunière plutôt que par Le Voyage
d’hiver, que vous chantez aussi en concert?
JK. : Comme je l’ai dit auparavant, pouvoir rendre le caractère de ce
jeune homme sans expérience était essentiel. Avec Le Voyage d’hiver, c’est
différent, le personnage n’est pas vieux non plus, mais il a une certaine
maturité et, vocalement, cela ne demande pas une aussi grande flexibilité
que La Belle Meunière. Mais j’espère aussi enregistrer les autres cycles
dans un futur pas trop lointain.
A la fin de La Belle Meunière, il y a ce dialogue entre le Meunier et le
Ruisseau, et ce dernier lied chanté entièrement par le Ruisseau. Est-il
important de différencier vocalement ces personnages, si tant est que le
Ruisseau soit un personnage?
J.K. : Il n’est pas nécessaire de vraiment changer de voix, comme on
le fait lorsqu’on raconte une histoire à des enfants. La différenciation
doit être plus naturelle. Le plus important, c’est l’esprit, le climat
magique de ce dernier lied, calme et doux. Cette berceuse, Gute Nacht, sans
ce contexte désespéré, pourrait être joyeuse...
Une des difficultés chez Schubert, c’est la structure strophique de
certains lieder, avec des mélodies qui se répètent plusieurs fois. Jusqu’où
peut-on varier l’expression d’une strophe à l’autre?
J.K. : Dans la plupart des cas, Schubert n’a noté des indications
d’interprétation que pour la première strophe. Cela nous ouvre donc d’autres
possibilités pour les suivantes. Dans «Der Lindenbaum», il a totalement
modifié la mélodie de la troisième strophe, et l’on trouve aussi des
changements dans «Die kalten Winde bliesen ». Pour moi, cela prouve qu’il a
toujours pensé que l’interprète pouvait recourir à des variations.
Malheureusement, un seul lied de La Belle Meunière nous est parvenu dans la
version autographe, c’est une frustration complète car Schubert prenait
beaucoup de libertés avec les règles de contrepoint et d’harmonie de son
temps, libertés qui ont été corrigées par les éditions successives. Mais
c’est à nous, interprètes, de les retrouver.
Que pensez-vous des chanteurs qui ont recours à l’ornementation?
J.K. : Je crois qu’ils ont raison, même si c’est très difficile à
accepter pour nous qui avons perdu cette habitude. Il existe une partition
annotée par Vogl, le chanteur ami de Schubert, qui comporte quantité
d’ornements. Et jusqu’à Strauss, jusqu’aux années 1930, il était normal
qu’entre les lieder, on ajoute des transitions, une improvisation, à partir
peut-être d’une autre mélodie, d’un opéra. Aujourd’hui, c’est inimaginable.
Le climat de cette Belle Meunière nous ramène indirectement à Werther et
à ce sentiment si particulier du romantisme allemand, cette fameuse
Sehnsucht — c’était aussi, à l’étranger, le titre de votre précédent album.
Etes-vous vous-même d’un naturel nostalgique ou mélancolique?
J.K. : Quiet non. Je me sens moderne, mais je me laisse aussi
facilement attendrir par une musique ou un poème. Je peux donc pénétrer ces
univers romantiques sans pour autant être obsédé par l’idée du suicide.
J’aime trop la vie!
Tant mieux! En quelques années, votre carrière a pris une dimension
nouvelle. Aujourd’hui, vous chantez partout dans le monde. Etiez-vous
préparé à cette vie?
J.K. : Là encore, oui et non. Je suis heureux que ce ne soit pas
arrivé quand j’étais trop jeune. J’ai toujours voulu prendre mon temps,
choisir la voie la plus stable, la plus normale, parce que dans les
générations précédentes, c’était la recette pour avoir une grande et longue
carrière. Je n’aime peut-être pas tout dans ce métier, mais j’aime vraiment
chanter et je préfère donc le faire le plus longtemps possible plutôt que de
connaître la gloire et gagner vite beaucoup d’argent. Je suis donc arrivé à
ce niveau en étant préparé, mais d’un autre côté, c’est ailé plus rapidement
que je ne le pensais. Au cours des cinq ou six dernières années,je ne crois
pas que ma voix, ma technique ou ma qualité de chant ont tellement évolué.
Ce qui est différent, c’est le public qui me suit partout pour noter chacun
de mes faits et gestes... Et le vrai cauchemar, c’est de parvenir à combiner
la carrière et une vie de famille avec trois enfants ! Surtout aujourd’hui,
lorsque vous devez apparaître chaque saison dans tous les grands Opéras, que
vous changez de ville tout le temps, que vous devez vous battre avec les
théâtres et les organisations de concerts si vous avez besoin de vous
reposer. Ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre quand on
vous fait des propositions formidables, avec les meilleurs chefs du monde,
dans des salles où tout est préparé pour vous. Vous êtes comme un enfant
dans un magasin de bonbons, c’est le paradis. Mais si tu en manges trop, tu
vas avoir mal au ventre!
Vous dites-vous parfois que vous aimeriez changer de vie?
J.K. : Oh oui! Aujourd’hui, je dois décider ce que je vais faire en
2016 ou 2017. Mais peut-être j’ouvrirai un bistrot Le danger de trop
travailler, c’est de perdre la joie, l’esprit, la passion et, dans ces
conditions, oui, on peut avoir envie de changer de métier. Ce n’est pas du
tout ce que j’ai l’intention de faire, mais si un jour ça devait arriver,
pour une raison ou pour une autre, cela ne me panique pas. Sinon, cela
voudrait dire que le seul plaisir, la seule satisfaction dans ma vie, serait
le succès sur scène. Et ce n’est pas comme ça. Je ne suis pas un esclave du
chant. Jusqu’à maintenant je suis très content de mon métier, parce que
c’est mon choix, pas mon devoir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|