|
|
|
|
|
|
|
|
Classique News, 20 avril 2023 |
|
Par Camille De Joyeuse |
|
|
CRITIQUE CD. PUCCINI : Turandot. Radvanovsky, Kaufmann, Pertusi… Antonio Pappano
|
|
|
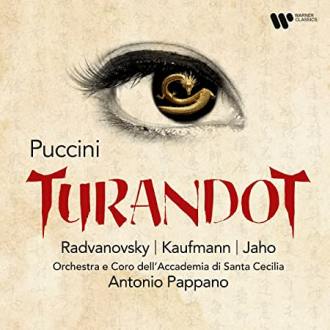 D’emblée
la direction d’Antonio Pappano sonne contrastée, parfois dure, plus
expressive voire expressionniste que riche en épanchement ou suggestion
poétique – dommage car le trouble habite la princesse chinoise : … de
vierge (f)rigide et hautaine, à mortelle adoucie qui s’éveille à l’amour
; même les évocations climatiques et d’ambiance, comme l’aurore qui
pointe au III, manquent de profondeur ou d’ivresse comme l’atteste
l’écriture musicale et ses formidables alliages de timbres et de
couleurs… D’emblée
la direction d’Antonio Pappano sonne contrastée, parfois dure, plus
expressive voire expressionniste que riche en épanchement ou suggestion
poétique – dommage car le trouble habite la princesse chinoise : … de
vierge (f)rigide et hautaine, à mortelle adoucie qui s’éveille à l’amour
; même les évocations climatiques et d’ambiance, comme l’aurore qui
pointe au III, manquent de profondeur ou d’ivresse comme l’atteste
l’écriture musicale et ses formidables alliages de timbres et de
couleurs…
PAPPANO chez PUCCINI :
une direction trop volcanique
?
Pourtant on ne saurait lui retirer des effets d’accents à
l’orchestre, même si de fait, cela semble exacerbé ou le fruit d’un
geste réducteur qui surligne l’opposition et les confrontations des
situations, moins la métamorphose qui s’accomplit … dommage car le chef
livrait ainsi son dernier grand opéra orchestral avant de laisser la
direction de l’orchestre cécilien à Daniel Harding.
L’enregistrement
réalisé à Rome en 2022, s’impose cependant par ses outrances, ses
déflagrations assumées (les tutti sont éruptifs) ; il convainc par cette
force, cette puissance souvent âpre de la masse orchestrale, plus
diamant brut que forge instrumentale superbement détaillée (comme chez
Karajan). Pappano restitue la version originale de Franco Alfano qui
écrit les 2 dernières scènes en 1926 (après la mort de Puccini),
validées / dictées en réalité par Toscanini. Puccini a en effet laissé
inachevé son ultime ouvrage, après la déploration de Liù, dans le choeur
qui déplore le suicide de cette dernière.
Le résultat est
intéressant mais parfois semble décousu comme un assemblage heurtée ou
pompier (reprise boursouflée de l’air « Nessun dorma » pour le chœur
final). Avouons préférer de loin la version plus psychologiquement
fluide et crédible de Luciano Berio de 2001, reprenant scrupuleusement
esquisses et manuscrits laissés par Puccini. Pas sûr que la version
Pappano 2022 s’impose naturellement vis à vis des (nombreuses) autres ;
mais au moins elle marque tel un avant signal opportun, le centenaire
Puccini en 2024.
Rappelons que la couleur introspective est
souvent gommée chez Puccini au profit des effets que permet son
orchestre saisissant – vrai bain expérimental ; Berio semble mieux
inspiré et plus juste en réduisant au minimum la part de réécriture, en
instillant aussi sa propre interprétation des indications de Puccini («
poi tristano », probable référence au Tristan de Wagner) ; Berio a
subtilement intégré ainsi l’accord de Tristan, tout en inscrivant
Turandot de Puccini dans le contexte musical de son époque, au début XXè
(avec présence des couleurs mahlériennes – 7ème symphonie-, ou du
Schönberg des Gurrelieder…). Autant d’apports d’un travail de fond qui
explique la parure orchestrale de premier plan d’un Puccini lui aussi
défricheur et créatif visionnaire, dont la texture nous semble ici un
rien réduite par un Pappano aux contrastes surchauffés.
Dans ce
travail strictement théâtral et spectaculaire, se distingue aussi le
choeur, présent / agissant (dirigé par Piero Monti). Les stars vocales
affichées tiennent leur promesse, surtout la Turandot de Sondra
Radvanovsky, entité féminine, altière, très aristo et d’une dignité
suprême et mûre ; la diva n’a plus l’âge de la princesse blessée /
indignée – plutôt très remontée contre la gent masculine : mais quels
aigus irradiés, quelle intensité foudroyée : voilà un cœur sacrifié qui
dans sa haine affichée est aussi meurtri et fragile ; hélas, Jonas
Kaufman ternit vocalement son personnage : son Calaf, prince mystérieux,
cet étranger par lequel s’accomplit le grand miracle de l’amour, s’il ne
manque pas d’éclat et de vaillance, on regrette souvent un chant en
surtension continuelle ; le timbre déploie cette raucité fauve qui se
connecte souvent mal avec la princesse, sujet de toutes ses attentions
sur le papier (« Nessun dorma » devient ici un air isolé, plus
crépusculaire qu’enivré de désir et de conquête).
Même
enthousiasme mesuré pour les autres rôles qui nécessitent pourtant une
éloquence mieux aboutie, subtile, précise : le temps des répétitions
a-t-il manqué ? Mais parfois il ne suffit pas de réunir un cast de luxe
pour atteindre à l’éblouissement. S’agissant de Turandot, il faut un
engagement calibré, nuancé, pour retrouver l’étoffe des rôles d’une
profondeur qui peine ici à faire surface ; cette finesse à peine
affleurée signe une lecture expressionniste, avare en nuances ; hélas
trop dure pour incarner la transformation générale qui fait passer d’une
Chine sanguinaire et barbare à cette apologie humaine, amoureuse,
collectivement réparée qui surgit grâce au prince étranger Calaf en fin
d’action.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|